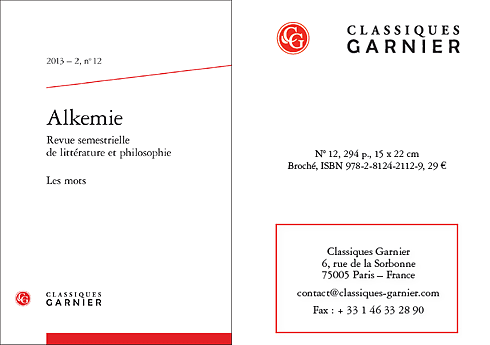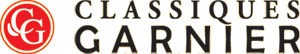|
« Comme tous les entre-deux, l'espace philosophico-
littéraire projette une lumière originale, féconde, enrichissante, sur les deux disciplines rapprochées ; mais, surtout, l'expérience de la confrontation de ces deux modes d'expression ne manquera pas d'encourager la reconnaissance d'une perspective unitaire plus stimulante encore. » (N. Cavaillès) |
Actualités
« L’objectif, finalement, c’est de tordre le langage, l’écriture pour étonner, perturber le lecteur et ainsi le rapprocher de la spécificité et de la singularité de l’animal en question. »
Entretien avec Éric BARATAY réalisé par Emmanuelle BRUYAS
 Emmanuelle Bruyas : Vous vous inscrivez dans un temps long de la réflexion, puisque, dès votre thèse, vous vous êtes intéressé à la question animale, spécifiquement à la relation entre l’Église et l’animal. Comment expliciteriez-vous l’évolution de votre cheminement de pensée ? Je songe en particulier au moment où vous avez considéré qu’il était important de réfléchir au niveau de l’individu animal et pas seulement des groupes d’animaux. Sentiez-vous que vous aviez atteint une limite ? Ou bien la confrontation avec certaines sources (documents, œuvres littéraires…) vous a-t-elle amené à oser adopter une autre forme d’approche ?
Emmanuelle Bruyas : Vous vous inscrivez dans un temps long de la réflexion, puisque, dès votre thèse, vous vous êtes intéressé à la question animale, spécifiquement à la relation entre l’Église et l’animal. Comment expliciteriez-vous l’évolution de votre cheminement de pensée ? Je songe en particulier au moment où vous avez considéré qu’il était important de réfléchir au niveau de l’individu animal et pas seulement des groupes d’animaux. Sentiez-vous que vous aviez atteint une limite ? Ou bien la confrontation avec certaines sources (documents, œuvres littéraires…) vous a-t-elle amené à oser adopter une autre forme d’approche ?Éric Baratay : Effectivement, nous vivons des ruptures dans les carrières. J’ai commencé la mienne, non pas au hasard, mais sous l’injonction d’un « ordre divin », j’aime bien dire cela pour plaisanter, puisque c’était un 15 août. J’étais allongé dans le hamac de la maison de campagne de mes parents, je cherchais un sujet de thèse et l’idée est tombée sur moi d’un coup : travailler sur les animaux. La légende dorée d’Éric Baratay précise qu’il a alors vu descendre une colombe, mais on n’est pas obligé de la croire ! C’était en 1985, je sortais de l’agrégation, je ne connaissais absolument pas le livre de Robert Delort qui venait de paraître en 1984. C’est venu comme cela, conciliant deux passions : l’histoire et les animaux. Ma thèse a donc porté sur l’Église et l’animal, XVIIe-XXe siècle. Elle appartenait à ce que j’appelle maintenant « l’histoire humaine des animaux » : comment des humains se représentent, pensent, utilisent et traitent les animaux. J’ai travaillé vingt ans selon cette approche, en fait comme tout le monde. C’est vers 2005-2007 que je me suis dit qu’il y avait un problème. On commençait à savoir beaucoup de choses côté humain, mais on ne savait quasiment rien côté animal. Cela s’est instillé en moi à la suite de la publication du livre Et l’homme créa l’animal, qui présentait une histoire de la condition animale, des origines à nos jours. C’était une synthèse, du côté humain, pour laquelle j’avais lu énormément de travaux, ce qui m’a permis de faire un bilan et ce constat. Or, si on travaille sur la relation entre les hommes et les animaux et si on veut bien comprendre cette relation, on ne peut pas s’en tenir à la connaissance d’un seul versant. Et quand on se plonge dans les sources, on voit bien que les humains de telle ou telle époque faisaient attention aux animaux, évidemment pas tous les humains, mais un bon nombre pour ajuster leur comportement en fonction. (…)
► Lire l’intégralité de l’entretien dans le n° 32 d’ALKEMIE
« C’est ce mystère dans la brisure du verre qui m’attire en tant que poète, qui me fait écrire et aller dans ma vie, je crois. C’est lui que je vais chercher à retrouver à travers mes marches dans ma forêt personnelle. »
Entretien avec Jean-Marc SOURDILLON réalisé par Mihaela-Gențiana STĂNIŞOR
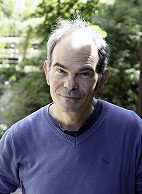 Mihaela-Genţiana Stănişor : « La déhiscence », c’est le mot qui ouvre votre dernier recueil poétique mais qui figure aussi dans d’autres livres. Que représente-t-il pour votre univers existentiel et littéraire ?
Mihaela-Genţiana Stănişor : « La déhiscence », c’est le mot qui ouvre votre dernier recueil poétique mais qui figure aussi dans d’autres livres. Que représente-t-il pour votre univers existentiel et littéraire ?Jean-Marc Sourdillon : Infiniment merci, chère Mihaela, de m’accueillir dans Alkemie, cette si belle revue que vous dirigez avec tant d’intelligence et de sensibilité, et de me permettre, grâce à vos questions, de faire le point sur ce qui se passe dans mon expérience de l’écriture poétique. Les mots, quand il s’agit de poésie, ont des racines qui plongent dans la vie concrète. Ainsi en va-t-il du mot « déhiscence » pour moi. C’est le titre que j’avais choisi pour le deuxième recueil de poèmes que j’ai écrit (j’avais 24 ou 25 ans) et qui, comme le premier, n’a pas été publié. Des séquences de ce livre ont paru dans la revue Le Nouveau Recueil, dirigée par Jean-Michel Maulpoix. C’est un mot qui appartient à la langue française et auquel je donne un autre sens que celui qu’il a dans le domaine de la botanique qui est le sien. Je l’avais découvert dans mes cours de biologie (j’étais dans une filière scientifique au lycée) et il m’avait semblé aussitôt qu’il s’appliquait à la situation personnelle que je traversais. Il désigne cette déchirure qui se produit dans le fruit d’une plante et par où ses graines, toutes ses semences, s’éparpillent autour d’elle. Une déchirure et une dissémination. Je l’ai retrouvé plus tard dans des emplois poétiques. Chez Claudel, par exemple, qui évoque une « déhiscence sidérale » à propos de cette célèbre phrase de Blaise Pascal : « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie ». Philippe Jaccottet, sans utiliser le mot, le définit parfaitement dans l’une de ses premières notes de La Semaison : « Dans un silence absolu, une lenteur douce, irrésistible, la plante se déchire et se dissémine, confiée au vent ». Il apparaît dans un de mes premiers poèmes publiés, j’avais seize ou dix-sept ans, dans cette expression : « déhiscence indécente ». C’était une manière pour moi, je crois, de nommer mon adolescence. Cette période a été vécue comme une longue, interminable déchirure où je ne cessais de me vider de moi, de me perdre, de m’arracher à moi-même – une hémorragie d’être, à la fois lumineuse et sanglante. Une sorte d’aliénation continue où tout ce qui avait fait que j’étais moi, que je me sentais moi, que je pouvais dire « Je » en parlant de moi, toutes mes raisons d’être n’avaient plus aucune valeur, ne cessaient de se consumer, de se réduire à rien. Je me souviens de ce moment d’une douleur aiguë, une sorte de sciatique psychique, où je ne voyais plus qu’une très intense lumière qui m’avait entièrement consumé, où je n’étais plus rien, juste une conscience qui souffre, où je ne voyais plus de place, pas d’ombre, pas de fraîcheur où me loger. Comme si l’on m’avait radiographié et que les rayons m’avaient effacé (moi mais pas ma conscience), comme si le monde m’avait éjecté. Tout part de là, je crois, dans l’écriture, de ce sentiment d’abolition de soi dans un éblouissement glacé, comme si on m’avait enfoncé deux aiguilles dans les yeux. L’écriture a été le moyen que je me suis trouvé pour traverser cela, m’inventer une façon d’être là-dedans, à la fois une corde de rappel et un fil à plomb, une manière de maintenir une direction et un lien avec, sinon moi, du moins ma vie. Ce que je ne voyais pas alors, tout entier concentré sur la déchirure et la sorte de douleur qu’elle provoquait, c’était que cette longue blessure était aussi celle d’une étrange sorte d’accouchement ; que, sans le savoir, parce que j’avais, sans vraiment non plus l’avoir voulu, accepté cette vulnérabilité, accepté de trouver graves les enjeux de ma vie, et de la vivre authentiquement (je ne savais pas faire autrement), je me laissais naître, je me donnais une chance de naître véritablement. C’en était, en quelque sorte, la condition. (…)
► Lire l’intégralité de l’entretien dans le n° 32 d’ALKEMIE
« Je suis porté vers les “miettes philosophiques”, les fragments existentiaux, les éclats, et plus encore à la conjonction du poème et du philosophème […]. Le poème est le noème. »
Entretien avec Rémi SOULIÉ réalisé par Mihaela-Gențiana STĂNIŞOR
 Mihaela-Genţiana Stănişor : Selon quels critères avez-vous choisi les auteurs auxquels vous avez consacré des livres ?
Mihaela-Genţiana Stănişor : Selon quels critères avez-vous choisi les auteurs auxquels vous avez consacré des livres ?Rémi Soulié : Essentiellement, selon le « bon plaisir », lequel se confond la plupart du temps avec une forme de nécessité intellectuelle : faire ses armes, lorsque le « moi » est d’abord perçu comme peu ou prou « haïssable » – il est vrai sur le mode d’une vaine crispation, aujourd’hui dépassée ; explorer une œuvre, une pensée auxquelles on s’identifie ou s’est identifié ce qui, je le reconnais, relève assez de la ruse avec soi-même. Les essais sur Dominique de Roux, Charles Péguy, Friedrich Nietzsche ou Benny Lévy sont donc très « personnels » en ce qu’ils constituent, dirait peut-être la spécialiste de Cioran que vous êtes, des « exercices d’admiration » dans lesquels transparaît une « image dans le tapis » où se tapit l’auteur. J’y ai, en effet, principalement évoqué les points qui me sont vitaux : l’essence de la littérature et du combat, le peuple et l’esprit, la lutte contre le nihilisme sous l’angle grec ou abrahamique. Lorsque je me suis senti plus assuré – ce fut comme une initiation ! – et que je m’y suis donc senti autorisé (par les auteurs), j’ai suivi Pindare et Nietzsche : « Deviens qui tu es ». Plus trivialement, comme ce que « je suis », sur un plan esthétique et intellectuel, ne correspond guère aux canons éditoriaux, sans doute fallait-il aussi en passer par des livres d’une facture un peu plus convenue ou attendue pour être publié.
M.-G. S. : Qu’est-ce que c’est pour vous écrire sur un autre ?
R. S. : Une manifestation de piété (l’hommage à des maîtres) et une autre façon d’écrire sur soi. Néanmoins, ultimement, Borges a raison : il n’y a jamais eu qu’une œuvre et un auteur. Le moi et l’autre sont des illusions, au sens de la maya des métaphysiciens de l’Inde. La langue, ici, correspondrait au Brahman. Le cœur, c’est elle, et en elle, le mot, la lettre même – d’où mon goût de l’imperatoria brevitas –, le hiéroglyphe synthétique et symbolique, le grain de sénevé, la musique des sphères, le son primordial, le « OM » auquel le scribe doit s’accorder. Lorsque tel est le cas, il comprend qu’Atmānest Brahman. Voilà pourquoi tout poème – j’entends, toute œuvre – même le plus sombre, est éveil, clarté, lumière. Les strates accumulées de la langue – l’histoire littéraire, donc – répètent le Même, qu’elles n’annoncent ni n’attendent puisqu’il a toujours été là (le poétique me paraît plus juste que le prophétique) ; encore est-ce trop dire qu’elles le « répètent » : elles le disent ; mieux : il se dit lui-même. La littérature, c’est le Dit du Dit. C’est « mon » côté éléate et mégarique : je suis émerveillé que l’être soit ; idéalement, j’aimerais l’être en permanence mais, comme les apôtres à Gethsémani, je suis atteint de narcolepsie : le pion pionce – je lis l’Évangile comme il doit être lu, c’est-à-dire comme la Baghavad Gītā : tout est question d’éveil. (…)
► Lire l’intégralité de l’entretien dans le n° 31 d’ALKEMIE
Arguments
L'idée d'une revue francophone internationale embrassant littérature et philosophie a le grand mérite de proposer une perspective transdisciplinaire : elle est d'autant plus bienvenue que, sans parler des œuvres littéraires à dimension philosophique (d'Homère à Kafka), ni des œuvres philosophiques à dimension littéraire (de Sénèque à Nietzsche), il existe, tout particulièrement dans le domaine francophone, avec un Montaigne, avec un Pascal, avec un Cioran, une longue et belle tradition de plumes qui ont refusé les dogmes séparés pour s'installer dans l'unité qui est celle de la pensée humaine.
Forte du soutien intellectuel des nombreux philosophes qui se sont penchés sur la littérature (de Platon à Derrida) et des nombreux écrivains qui ont servi des thèses et des idées (de Dante à Proust), forte de l'autorité conférée par son ouverture à des philosophes comme à des critiques littéraires aussi distingués qu'Irina Mavrodin, Antoine Compagnon, Sorin Vieru, ou encore Ger Groot, la revue Littérature et philosophie touche au problème décisif de la vérité de l'existence humaine, son langage : la vérité du monde s'exprime-t-elle en concepts, ou en métaphores ? Comme tous les entre-deux, l'espace philosophico-littéraire projette une lumière originale, féconde, enrichissante, sur les deux disciplines rapprochées ; mais, surtout, l'expérience de la confrontation de ces deux modes d'expression ne manquera pas d'encourager la reconnaissance d'une perspective unitaire plus stimulante encore.
Pour avoir moi-même conjugué des recherches philosophiques et littéraires, je suis personnellement honoré et fort impatient de participer à une aventure intellectuelle aussi prometteuse.
Forte du soutien intellectuel des nombreux philosophes qui se sont penchés sur la littérature (de Platon à Derrida) et des nombreux écrivains qui ont servi des thèses et des idées (de Dante à Proust), forte de l'autorité conférée par son ouverture à des philosophes comme à des critiques littéraires aussi distingués qu'Irina Mavrodin, Antoine Compagnon, Sorin Vieru, ou encore Ger Groot, la revue Littérature et philosophie touche au problème décisif de la vérité de l'existence humaine, son langage : la vérité du monde s'exprime-t-elle en concepts, ou en métaphores ? Comme tous les entre-deux, l'espace philosophico-littéraire projette une lumière originale, féconde, enrichissante, sur les deux disciplines rapprochées ; mais, surtout, l'expérience de la confrontation de ces deux modes d'expression ne manquera pas d'encourager la reconnaissance d'une perspective unitaire plus stimulante encore.
Pour avoir moi-même conjugué des recherches philosophiques et littéraires, je suis personnellement honoré et fort impatient de participer à une aventure intellectuelle aussi prometteuse.
Nicolas Cavaillès
Comme dans la plupart des secteurs de la pensée, nous assistons à une atomisation du savoir humain, sans doute nécessitée par la progression même de la recherche scientifique, s'aventurant de plus en plus loin dans les zones inconnues, apparemment inconnaissables de l'esprit. C'est là que les frontières entre les disciplines se touchent, s'effacent même, c'est l'immense lieu de rencontre où la philosophie, dans le sens de la sagesse antique, et la poésie, exploratrice de l'imaginaire, se donnent rendez-vous, rejoignant également la pensée théologique, la science de Dieu, de la Parole et de l'Écriture.
Eugène Van Itterbeek
Les relations entre la littérature et la philosophie ont depuis toujours nourri les réflexions des créateurs, qu'ils soient philosophes ou hommes de lettres. Nombreux sont ceux qui prétendaient que la philosophie se distinguait radicalement de la littérature, aussi par la forme que par le contenu. Si la première exprimait la vérité par un langage conceptuel, qui aspire à l'universalité, la deuxième chercherait partout la beauté, se servant dun langage symbolique et métaphorique qui possède un grave substrat personnel. D'autres considéraient que tout est littérature, c'est-à-dire préoccupation pour l'expression et pour le langage. Les œuvres de Nietzsche, Mallarmé, Proust, Joyce révèlent que cette association entre littérature et philosophie est non seulement possible mais encore harmonieuse, tant l'une se nourrit de l'autre. La légitimité d'un tel rapport est prouvée historiquement par l'ancienne unité de la poésie et de la philosophie. Le problème de la relation art et philosophie préoccupait Nietzsche qui écrivait dans Le Livre du philosophe : « Grand embarras de savoir si la philosophie est un art ou une science. C'est un art dans ses fins et sa production. Mais le moyen, la représentation en concepts, elle l'a en commun avec la science. » Lire tout l'article...
Mihaela-Genţiana STĂNIŞOR
Răzvan ENACHE
Răzvan ENACHE
Mots-clefs :
métaphore et concept,
le fragmentaire,
l'autre,
le rêve,
le vide,
Cioran,
la solitude,
le mal,
l'être,
le destin,
le bonheur